
. Un accord a été trouvé hier, mardi 1er octobre, entre les autorités comoriennes, les syndicats des commerçants (notamment le Synaco), et les syndicats des chauffeurs de taxi (notamment Usukani wa Masiwa), mettant fin à la grève qui avait paralysé une partie du pays ces derniers jours. Si l’entente obtenue marque une avancée pour les travailleurs du secteur informel et des transports, un autre sujet a enflammé les réseaux sociaux : l’absence remarquée de la génération Z dans la mobilisation.
Sur TikTok, Facebook et WhatsApp, beaucoup attendaient une montée en puissance d’une jeunesse combative, à l’image des soulèvements récents à Madagascar ou au Népal, où des mouvements étudiants et de jeunes travailleurs ont bloqué des institutions, mené des marches massives et défié les autorités dans des contextes de crise politique.
Mais aux Comores, cette « nouvelle jeunesse », née entre la fin des années 1990 et les années 2000, est restée en retrait. Ce silence a provoqué une vague de critiques en ligne. Certains reprochent à cette génération de « n’avoir que la musique en tête », d’être « happée par les réseaux sociaux », ou encore « plus préoccupée par la mode et les clashs que par la politique ».
Pourtant, ce regard est injuste, voire injustifié historiquement.
Il faut rappeler qu’il y a moins de dix mois, la jeunesse comorienne était au premier plan des manifestations qui ont secoué le pays à la suite des élections présidentielles de janvier 2025, jugées par beaucoup comme frauduleuses. Cette période avait été marquée par plus d’une semaine de violences urbaines, de graves affrontements entre jeunes manifestants et forces de l’ordre, et un climat de peur dans plusieurs quartiers de Moroni et d’autres villes.
Des témoignages ont fait état d’arrestations arbitraires, de détentions sans jugement, voire de cas de torture. Des noms comme Islam, un jeune manifestant mort sous les coups, sont devenus des symboles tragiques de cette contestation réprimée dans le sang. À l’époque, c’est bien cette génération Z qui avait tenu tête au pouvoir, souvent sans soutien structuré, ni encadrement politique.
La mémoire courte, ou la mémoire sélective ?
Ainsi, accuser aujourd’hui cette même jeunesse de passivité est une forme d’amnésie collective. Car si elle ne s’est pas manifestée de manière spectaculaire lors de cette grève des commerçants et des taxis, c’est peut-être aussi par fatigue, par traumatisme, ou tout simplement par lucidité sur les risques encourus. Beaucoup n’ont pas oublié les arrestations de janvier. D’autres, encore mineurs à l’époque, ont vu leurs frères ou voisins subir des violences.
Certains évoquent aussi une désorganisation profonde, une absence de relais structurés pour transformer les colères numériques en actions concrètes sur le terrain. Il ne s’agit donc pas tant d’un désintérêt que d’un vide stratégique : la jeunesse comorienne manque d’espaces pour canaliser sa puissance politique.
Le rôle des anciens : comprendre, pas mépriser
La réaction des aînés, qui tourne trop vite à la moquerie ou au reproche, ne fait qu’aggraver la fracture. Car cette génération Z n’a pas grandi dans les mêmes conditions que les précédentes : elle est née avec Internet, dans un monde hyperconnecté mais aussi profondément instable. Elle a vu l’échec de nombreuses figures politiques, les trahisons, les silences coupables. Son rapport à la politique est marqué par le doute, l’individualisme défensif, mais aussi le désir d’un renouveau profond, à condition qu’il soit crédible.
Et maintenant ?
Il est donc urgent de changer de regard sur cette jeunesse : non pas l’attendre seulement quand les rues s’embrasent, mais l’impliquer en amont, l’écouter, la former, l’associer aux décisions, y compris dans les syndicats et les structures locales.
Car la génération Z comorienne n’est pas absente. Elle est en attente. Elle observe. Elle se méfie. Mais elle est là. Et quand elle se lèvera de nouveau, nul ne pourra l’ignorer.
ANTUF Chaharane
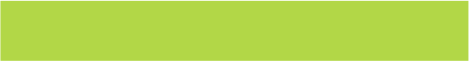
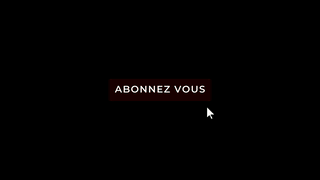
Réagissez à cet article