
La crise politique à Madagascar atteint un tournant décisif. Ce mardi 14 octobre 2025, les députés malgaches ont voté la destitution du président Andry Rajoelina, malgré la publication quelques heures plus tôt d’un décret présidentiel dissolvant l’Assemblée nationale.
Une manœuvre de dernière minute qui n’a pas empêché le Parlement d’aller au bout de la procédure d’empêchement temporaire pour abandon de poste.
Une dissolution pour bloquer le vote de destitution
Dans la matinée, la présidence malgache avait annoncé, via sa page Facebook officielle, un décret pris en application de l’article 60 de la Constitution, proclamant la dissolution de l’Assemblée nationale.
Selon Andry Rajoelina, cette décision visait à « rétablir l’ordre et renforcer la démocratie » dans un contexte de tension croissante. Le chef de l’État, apparu depuis un lieu inconnu, avait parallèlement appelé à « respecter la Constitution » et rejeté toute idée de démission.
Mais pour de nombreux observateurs, cette dissolution était avant tout une tentative de bloquer le vote de destitution prévu le même jour par les députés, qui l’accusaient d’avoir quitté le territoire sans délégation de pouvoir, ce qui constituait un abandon de poste.
Les députés bravent le décret présidentiel
Malgré ce décret controversé, les parlementaires se sont réunis en session extraordinaire et ont procédé au vote de destitution.
Selon plusieurs sources parlementaires, 130 députés sur 163 ont voté en faveur de la motion, soit largement au-dessus de la majorité des deux tiers requise.
Pour eux, la dissolution n’avait aucune validité juridique, car le président ne pouvait plus exercer ses prérogatives « du fait de son absence prolongée et non justifiée ».
« La vacance du pouvoir est manifeste. Le président a quitté le pays sans informer la nation », a déclaré un élu de l’opposition. Ce vote marque une rupture institutionnelle majeure : deux autorités se disputent désormais la légitimité du pouvoir à Antananarivo.
Le rôle décisif de l’armée
La tension a redoublé lorsque le CAPSAT, une unité militaire d’élite déjà impliquée dans le coup d’État de 2009, a annoncé son ralliement à la contestation populaire.
Ses dirigeants, dont le colonel Michael Randrianirina et le général Pikulas Démosthène, ont déclaré « refuser de tirer sur le peuple » et ont proclamé que l’armée prenait ses responsabilités pour assurer la stabilité du pays.
Peu après le vote, ces officiers ont annoncé la mise en place d’un gouvernement militaire transitoire, suspendant plusieurs institutions dont la Haute Cour constitutionnelle et le Sénat.
Un pays à la croisée des chemins
Entre le décret présidentiel de dissolution, la destitution parlementaire, et la prise de contrôle de l’armée, Madagascar se retrouve plongé dans une triple crise institutionnelle.
Le président Rajoelina, qui affirme toujours être le chef de l’État, dénonce une « manœuvre illégale » et appelle à la résistance constitutionnelle.
De leur côté, les militaires justifient leur action par la nécessité de « restaurer la confiance entre l’État et le peuple ».
La communauté internationale suit de près la situation.
Seize ans après le coup d’État de 2009, l’île rouge semble revivre les mêmes fractures, entre pouvoir contesté, institutions paralysées et armée arbitre du destin national.
ANTUF Chaharane
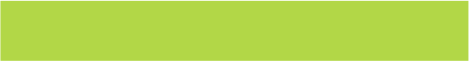
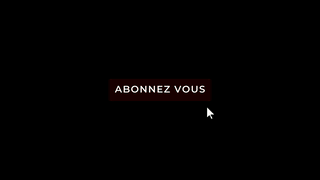
Réagissez à cet article