
Chaque fait divers tragique relance le débat : faut-il rétablir la peine de mort aux Comores ? Face à l’émotion et à la colère suscitées par des crimes odieux, certains réclament l’application stricte du Code pénal, où la peine capitale est toujours prévue. Mais au-delà de l’indignation, cette sanction est-elle une réponse efficace à la criminalité ou une illusion de justice ?
L’un des principaux arguments en faveur de la peine de mort est son effet dissuasif. Pourtant, l’expérience montre qu’aucun pays n’a réussi à éradiquer les crimes graves grâce à son application.
- Des chiffres qui parlent : Aux États-Unis, les États qui pratiquent encore la peine capitale n’ont pas des taux de criminalité plus bas que ceux qui l’ont abolie. En France, avant son abolition en 1981, les homicides étaient plus nombreux qu’aujourd’hui.
- Un précédent aux Comores : Depuis l’indépendance, trois exécutions ont eu lieu – une sous Ali Soilih, deux sous Mohamed Taki. Pourtant, elles n’ont pas mis fin aux crimes violents.
Alors, si la peine de mort ne dissuade pas, que cherche-t-on réellement à obtenir en l’appliquant ?
Appliquer la peine capitale suppose une justice infaillible. Mais aux Comores, de nombreuses voix dénoncent des dysfonctionnements majeurs dans le système judiciaire :
- Des enquêtes bâclées,
- Des décisions influencées par la politique,
- Des aveux extorqués sous la torture.
Dans ces conditions, comment garantir qu’un innocent ne sera pas condamné à mort ? L’histoire regorge d’erreurs judiciaires, et certaines n’ont jamais pu être réparées.
Là où elle existe, la peine de mort touche principalement les catégories les plus vulnérables :
- Les pauvres, qui n’ont pas accès à une bonne défense,
- Les minorités, souvent surreprésentées parmi les condamnés,
- Les personnes atteintes de troubles mentaux, mal comprises par le système judiciaire.
Aux Comores, où la justice est déjà perçue comme inégalitaire, qui seraient les principales victimes d’une peine capitale rétablie ?
Face à l’horreur d’un crime, la peine de mort est souvent perçue comme une réparation, une forme ultime de justice. Mais tuer un criminel ramène-t-il une victime à la vie ? Soulage-t-il réellement la douleur des familles ?
Une société peut-elle condamner un meurtre… en commettant un autre meurtre au nom de la justice ?
La criminalité a des causes profondes :
- Précarité,
- Manque d’éducation,
- Absence d’opportunités,
- Problèmes de santé mentale.
Plutôt que d’instaurer la peine de mort, pourquoi ne pas lutter contre ces facteurs à la source ? Pourquoi ne pas améliorer l’éducation, la justice et les conditions de vie des citoyens ?
- La peine de mort a-t-elle réellement un effet dissuasif ?
- Peut-on garantir qu’aucun innocent ne sera condamné ?
- La justice comorienne est-elle assez fiable pour appliquer une telle sanction ?
- Une société peut-elle condamner le meurtre en l’utilisant elle-même ?
- Pourquoi ne pas investir dans des solutions à long terme plutôt que dans une répression extrême ?
Avant de réclamer des exécutions, peut-être faudrait-il d’abord s’assurer que notre justice, notre société et notre État sont en mesure de rendre une justice véritablement équitable.
Misam
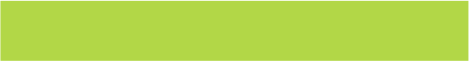
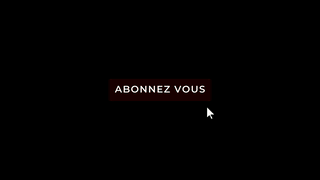
Réagissez à cet article